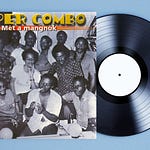Un rêve titanesque, une main-d’œuvre caribéenne sacrifiée
La construction du canal de Panama, traversant l’isthme étroit reliant les océans Atlantique et Pacifique, est l’un des projets d’ingénierie les plus ambitieux de l’histoire moderne. Inauguré en 1914, ce passage stratégique a bouleversé les routes maritimes et accéléré les échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Pourtant, derrière cette prouesse technologique se cache une autre histoire : celle des Antillais, travailleurs invisibles d’un chantier infernal, venus en masse de Guadeloupe, Martinique, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Trinidad et d'autres îles caribéennes.
Contexte : Pourquoi un canal au Panama ?
Au XIXe siècle, relier les deux côtes des États-Unis (New York - San Francisco) nécessitait de contourner le Cap Horn par le sud de l’Amérique du Sud, soit 22 500 kilomètres de navigation. Avec un canal traversant l’isthme de Panama, ce trajet pouvait être réduit à 9 500 kilomètres, révolutionnant le commerce maritime mondial.
L'idée d'un canal remonte au XVIe siècle, mais c’est à la fin du XIXe siècle que le projet prend forme. En 1881, le Français Ferdinand de Lesseps, déjà célèbre pour le canal de Suez, lance les premiers travaux. Mais confrontée à des conditions géographiques et sanitaires extrêmes, sa tentative échoue en 1889 dans un scandale financier majeur.
Les Antillais au cœur du chantier
Un recrutement massif depuis les Antilles
Attirés par les promesses d’un emploi stable et mieux rémunéré, des dizaines de milliers d’Antillais quittent leurs îles. Le recrutement est particulièrement intense à la Barbade, mais également en Guadeloupe et Martinique, souvent via des campagnes de propagande mensongères vantant un "eldorado" industriel. Ces hommes partaient souvent sans savoir ce qui les attendait.
⚠️ Ils représentaient jusqu’à 70 % de la main-d’œuvre sur certains segments du chantier.
Des conditions de travail infernales
La réalité est brutale : une jungle hostile, infestée de moustiques porteurs de malaria et de fièvre jaune, des glissements de terrain, des conditions climatiques extrêmes et une ségrégation raciale profondément ancrée.
Les ouvriers noirs, dont les Antillais, étaient assignés aux tâches les plus pénibles et les plus dangereuses, pour un salaire de misère (10 cents/heure). Ce système, connu sous le nom de "Silver Roll", les distinguait des employés blancs ou qualifiés (souvent payés en or - "Gold Roll") bénéficiant de logements décents et d’avantages.
Une hécatombe silencieuse
Les estimations varient, mais on parle de 27 500 ouvriers morts pendant les travaux, dont une majorité venue des Caraïbes. La mortalité est due aux maladies, aux accidents, aux éboulements, mais aussi à l'épuisement pur et simple.
Des cimetières antillais à Paraíso, Culebra ou encore à Ancon, témoignent encore de ce lourd tribut. Les croix numérotées portent la trace d’hommes anonymes, dont les noms sont conservés dans des registres à Washington.
Le rôle des États-Unis et la finalisation du chantier
Après l’échec français, les États-Unis rachètent la concession en 1904. Ils appuient même l’indépendance du Panama, alors province colombienne, pour s’assurer le contrôle stratégique de la zone du canal.
Sous l’impulsion du président Theodore Roosevelt, les Américains imposent une vision plus pragmatique : un canal à écluses (et non à niveau), plus adapté à la topographie. Les travaux reprennent avec des mesures sanitaires améliorées, des structures logistiques solides, et une organisation militaire du chantier.
Les écluses et le triomphe technologique
Longueur du canal : 77 km
Nombre d’écluses : 3 (Gatún, Pedro Miguel, Miraflores)
Volume d’eau par passage : 197 millions de litres
Nombre annuel de navires : plus de 14 000
Part du commerce maritime mondial : 6%
Un canal, un cimetière, une mémoire
En 1914, le navire Ancon réalise la première traversée du canal. À bord : des officiels américains et panaméens, mais aucun Antillais, malgré leur rôle central. Pourtant, des voix se sont élevées pour préserver cette mémoire.
Le romancier Joseph Jos a documenté les histoires de ces hommes dans Guadeloupéens et Martiniquais au canal de Panama.
Maryse Condé, dans La Vie scélérate, évoque le destin d’un ouvrier guadeloupéen à travers le personnage d’Albert Louis.
Des sociétés de secours mutuel ont vu le jour, comme La Fraternité, fondée par des Antillais en 1917 à Panama.
Un héritage à deux visages
Fierté et oubli
Le canal de Panama est considéré comme l’une des 7 merveilles du monde moderne, un triomphe de l’ingéniosité humaine. Mais pour les descendants des travailleurs antillais, c’est aussi le symbole d’un sacrifice oublié, d’une mémoire effacée par les récits dominants occidentaux.
Une diaspora enracinée au Panama
Beaucoup d’Antillais ne sont jamais retournés chez eux. Le Panama compte aujourd’hui une communauté afro-antillaise, avec une culture et une histoire fortement marquées par cet héritage.
Aujourd’hui : un canal toujours stratégique
Depuis son élargissement en 2016, le canal peut accueillir des navires de très grand tonnage.
Il génère plus d’un milliard de dollars par an pour le Panama (environ 7 % de son PIB).
Il reste un nœud logistique crucial, au cœur des tensions géopolitiques et de la mondialisation.